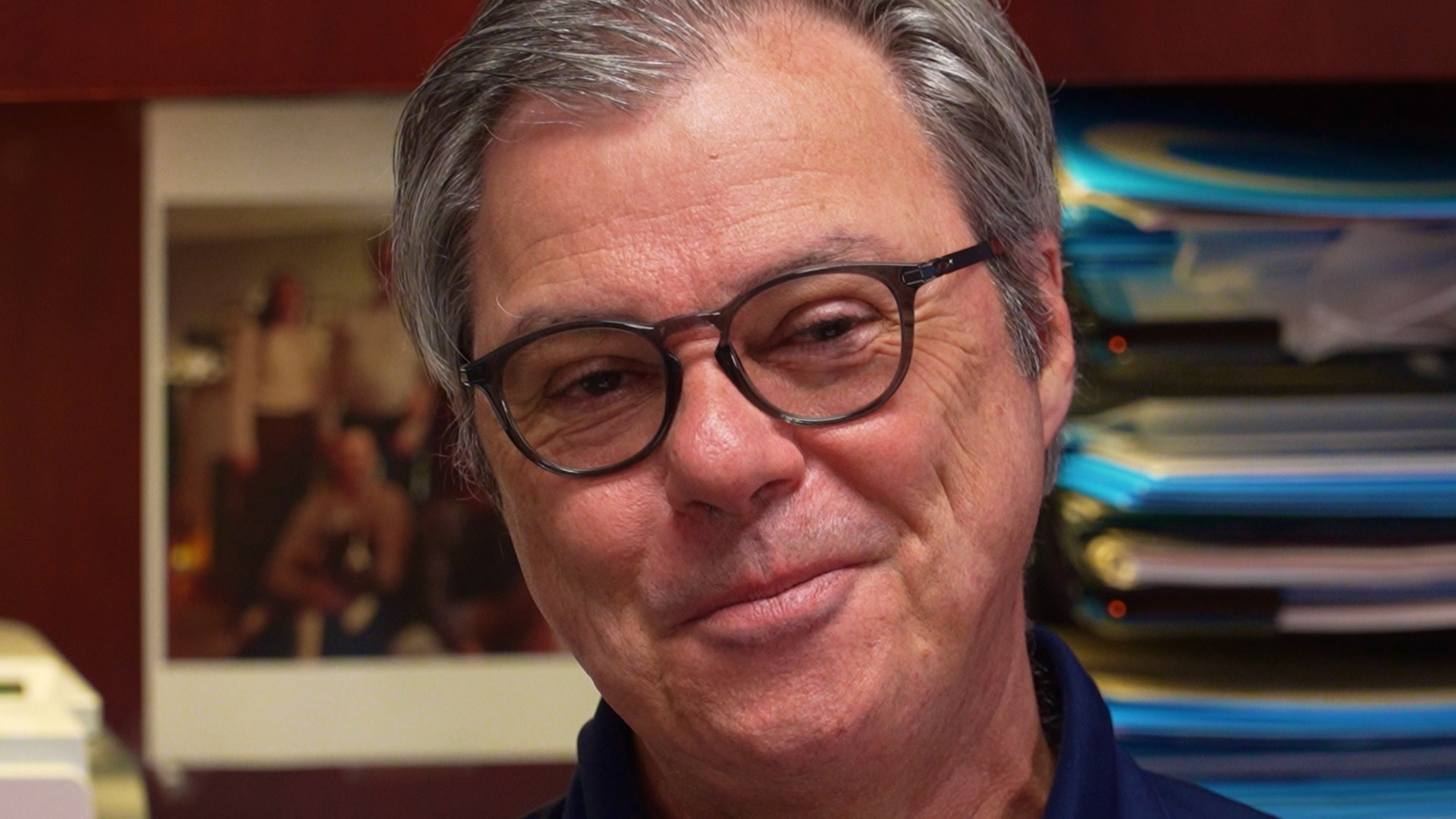On a le choix
Delphine Petitjean
IJL-Réseau.Presse-On a le choix
Rédactrice en chef et journaliste
Delphine est diplômée en études de la communication et des médias ainsi qu'en rédaction web et enseignement. Elle a débuté en presse écrite en Belgique, puis s'est dirigée vers le domaine de l'insertion professionnelle et de la formation. Au Canada, elle a été chargée de projet, a eu quelques collaborations en rédaction, avant de se former à la réalisation documentaire et de co-fonder On a le choix Média.
Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de ces 30 ans justement ?
Je suis arrivé ici en 1993 un peu par accident. Il y avait une annonce dans un journal du Québec qui recherchait un organisateur communautaire et quand j’ai vu la description du type d’organisation, ça correspondant aux valeurs que j’avais déjà en ce temps-là. C’était très communautaire, mais en même temps avec un volet santé important. [….] C’était une transition pour moi parce que j’étais dans le développement international comme coopérant volontaire […] Je connaissais à peine Cornwall et la réalité des Franco-ontariens étant Québécois d’origine […] Finalement, on m’a donné le poste et c’était une toute petite organisation qui était appelée à grandir. J’ai trouvé ça extrêmement stimulant et une très grande liberté de la direction générale à l’époque. Je pouvais pratiquement forger ma propre description de tâches, ce n’est pas souvent qu’on a des occasions comme ça. […] On a appris à connaître la vivacité et puis la complexité de la communauté franco-ontarienne du coin et ça nous a ouvert beaucoup d’horizons. Même comme Québécois à l’époque, ça m’a fait comprendre un peu plus la démarche canadienne, comment c’est important aussi. Parce qu’on a une vision quand on est au Québec, une vision qui est plutôt fermée puis ce n’est pas un reproche, c’est juste une question de protectionnisme qu’on vit puis c’est important de protéger sa langue puis sa culture. Mais quand on arrive à l’extérieur du Québec et qu’on voit qu’il y a des réalités de Franco-canadiens qui ont eux aussi ce sentiment-là et ce besoin de conservation, de protection de leur langue, ça crée un milieu stimulant pour travailler et c’est comme ça que j’ai commencé tranquillement à travailler avec les organisations communautaires du coin, les personnes âgées, les groupes de jeunesse. On a créé des jardins communautaires et toutes des choses qui étaient rassembleuses.
Comment était le paysage de la francophonie locale à l’époque si on compare à maintenant ?
Elle a changé. Il y a eu un vieillissement de la population. On le ressent dans notre centre ici, on voit que la population franco-ontarienne est vieillissante et on sentait qu’il manquait un peu de relève à ce niveau-là. À titre d’exemple, mes enfants allaient dans une école publique française et c’était une très petite école. On ne sentait pas le dynamisme très fort au niveau des familles. Ça a évolué et il y a eu aussi une vague d’immigration très intéressante dans les dernières années à Cornwall […] qui recrée cet intérêt-là au niveau de la francophonie parce qu’on a souvent l’impression que les nouveaux arrivants, on les dirige automatiquement vers les ressources en anglais. Alors c’est un dynamisme qu’on avait besoin de recréer entre nous pour être sûr que comme francophones, au moins les gens ont l’option d’aller où ils veulent aller et avoir les services qu’ils veulent, d’où la nécessité d’avoir un centre de santé communautaire francophone, avoir une équipe psycho sociale pour les services aux jeunes en français, mais il faut que les gens le sachent et puissent en profiter. […] Je pense qu’il y a de l’espoir alors qu’il y a 30 ans, il y avait moins d’espoir pour la communauté francophone.
Et au niveau des soins de santé, racontez-moi l’évolution
Ça, c’est très important parce que c’est un groupe de femmes francophones qui a créé ce centre de santé communautaire-là, il ne faut jamais l’oublier. Il y a eu dans les années 80 beaucoup de fermetures de manufactures. La ville de Cornwall est une ville manufacturière, ouvrière, industrielle et avec le déclin de l’économie, ces emplois-là sont partis. Beaucoup de francophones étaient des travailleurs de ces industries-là et se sont retrouvés du jour au lendemain avec pas grand-chose comme services, entre autres des besoins en santé mentale ou en support autres que des soins primaires. […] Avec le ministère à l’époque, ils ont décidé de créer un centre de santé communautaire pour avoir une approche plus holistique. On a eu des débuts très modestes. […] Ce dont on s’est rendu compte, c’est qu’il y avait beaucoup de pauvreté chez les francophones et très peu de services disponibles pour eux. Il y avait des services en anglais, mais ce n’était pas toujours adapté à leurs besoins culturels et linguistiques. […] Quand j’ai commencé à travailler, il y avait 12 ou 15 employés, pas plus. Et puis aujourd’hui, on en a 115, donc les besoins étaient réels. Puis on a été capables de bâtir ça en partie de la mobilisation de ces communautés tout le temps. […] Avec la clientèle immigrante, il a fallu développer une sensibilité culturelle en plus d’une sensibilité linguistique. […] Ce qu’on veut, c’est les attirer dans notre communauté francophone. Mais nous, on doit jouer notre rôle aussi.
Quels sont les grands combats qu’il a fallu mener et quels sont encore les grands enjeux ?
Le grand combat est de faire sa place, ça c’est continu parce qu’il y a beaucoup de gens qui vont dire que la plupart des francophones sont bilingues, donc quelle est la nécessité ? Mais ça évolue dans le bon sens. […] Il y a des enjeux qui ont été identifiés comme étant clairs, c’est qu’à un moment, pour être capable d’avoir une certaine qualité de service, pour être capable de faire les bons choix, il faut que la personne soit capable de s’exprimer dans sa langue de choix. Il y a des gens qui s’expriment dans les deux langues. […] Mais on s’est rendu compte, et des études le prouvent, que quand la personne est dans une situation de vulnérabilité, la langue redevient extrêmement importante et pour l’intervenant qui veut travailler avec cette personne-là, la communication et l’élément de confiance, de compréhension, ça fait partie du diagnostic, sinon on n’est pas capable d’établir un diagnostic qui est solide. Et comment on aide une personne avec laquelle on a de la difficulté à communiquer ? C’est un défi pour l’intervenant aussi. […] Ça demeure un enjeu, mais je pense qu’il y a quand même eu une évolution, mais en même temps, toujours dans le respect des compétences des autres parce qu’il ne faut pas arriver en disant : on est les seuls qui sont capables de faire ça. Il faut arriver comme un partenaire, toujours. Dire : on a un rôle à jouer et si vous pensez que c’est une bonne chose, on va travailler avec ça.