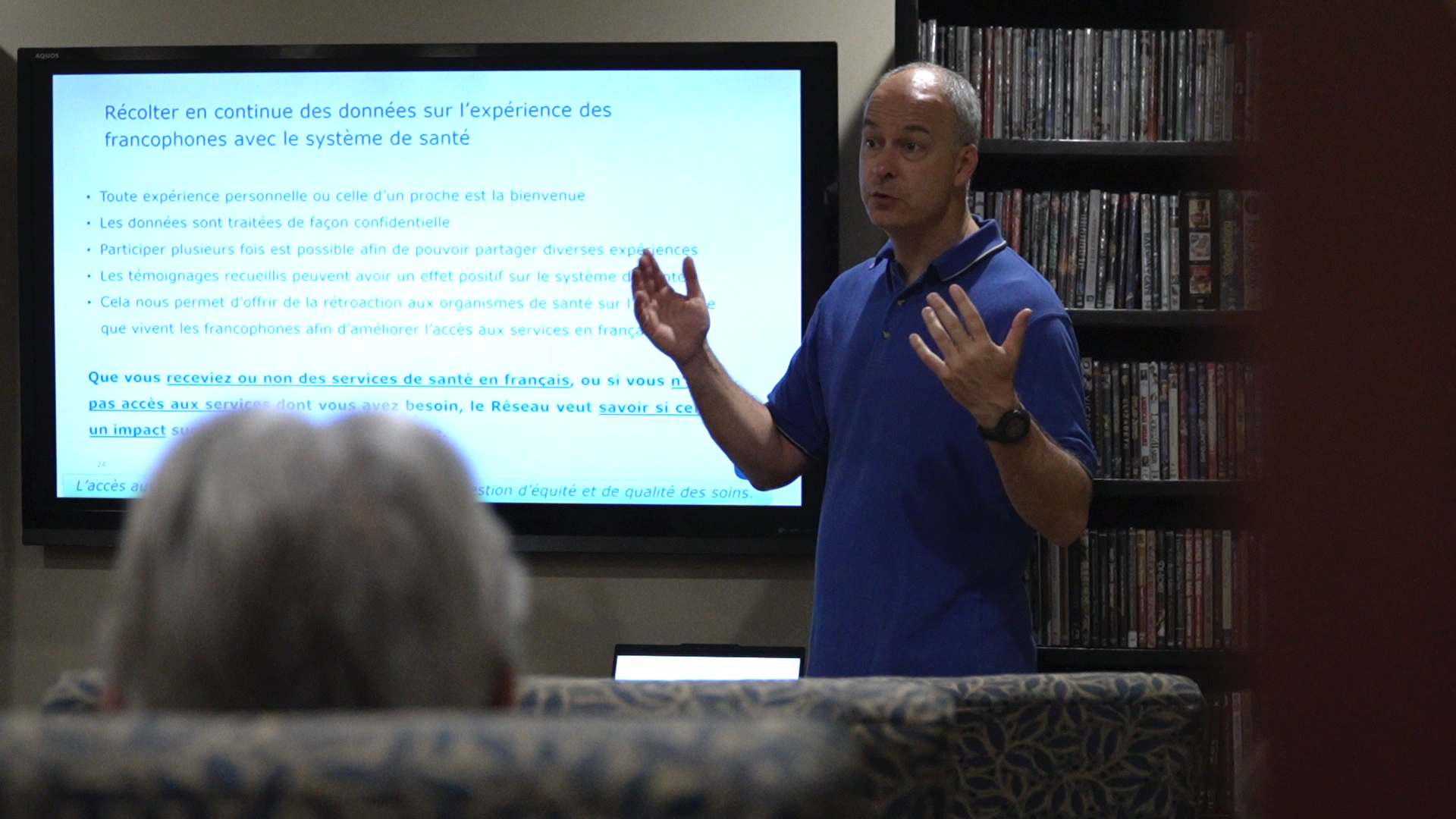On a le choix
Delphine Petitjean
IJL-Réseau.Presse-On a le choix
Rédactrice en chef et journaliste
Delphine est diplômée en études de la communication et des médias ainsi qu'en rédaction web et enseignement. Elle a débuté en presse écrite en Belgique, puis s'est dirigée vers le domaine de l'insertion professionnelle et de la formation. Au Canada, elle a été chargée de projet, a eu quelques collaborations en rédaction, avant de se former à la réalisation documentaire et de co-fonder On a le choix Média.
Ce que dit la loi
Selon la présentation réalisée par Normand Glaude, directeur général du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (Rssfeo), en vertu de la loi, la population peut recevoir des services en français dans 27 régions désignées de la province :
- auprès d’un ministère ontarien ou d’un organisme gouvernemental
- au siège social du ministère ou de l’organisme gouvernemental
- au bureau local situé dans une région désignée (p.ex. Service Ontario; cour de justice; etc.)
- dans un organisme désigné en vertu de la loi sur les services en français
Le ministère de la Santé délègue la prestation à environ 1400 fournisseurs en Ontario (hôpitaux, centres de santé communautaire, organismes de santé mentale, organismes de soutien communautaire, centres de soins de longue durée).
Il y a 83 organisations désignées totalement ou partiellement sous la loi pour offrir les services qui ont la capacité, une offre active et une obligation de le faire.
Témoignages
« On sait qu’il y a des barrières linguistiques qui existent et si la communication entre le patient et le prestataire de service n’est pas dans une langue où il y a une communication fluide, l’enjeu est que, des fois, le diagnostic ou l’acceptation des soins, ce n’est pas optimal. », indique Normand Glaude.
Le Rssfeo offre la possibilité au public de témoigner anonymement. « On a une ligne d’écoute qui nous permet essentiellement d’entendre ce que les gens vivent et on peut bien comprendre l’effet direct. Par exemple, on a entendu des personnes qui ont eu de faux diagnostics de problème de santé, alors que le problème était lié à l’anxiété de ne pas pouvoir communiquer. »
Sondages et constats
Entre 2022 et 2024, l’organisme a sondé des utilisateurs de soins de santé de 18 à 65 ans, parents ou proches aidants, principalement dans l’Est ontarien et la région d’Ottawa.
Quelques constats sur la perspective des répondants :
- Peu importe le niveau de capacité en anglais ou la raison qui les amène à consulter un professionnel de la santé, les patients veulent recevoir leurs services en français.
- Même s’il y a eu une identification linguistique au premier contact, les patients ne se sentent pas reconnus comme étant des francophones par la suite.
- Les services en français sont laissés au hasard. D’après les témoignages, le personnel soignant compte sur la débrouillardise et le bilinguisme des patients francophones. Cette situation ajoute au stress et à l’inquiétude de la condition de santé et contribue à un sentiment d’inadéquation de la part du patient.
« Je travaille aussi avec un groupe de chercheurs qui sont en train d’étudier l’utilisation des soins à domicile et des soins palliatifs qui sont liés à ça et ce qu’ils ont observé, c’est qu’à travers le Canada, en général, les francophones qui vivent en situation minoritaire sont 40 % de fois plus propices à avoir plus que 7 médicaments que le restant de la population. Donc, c’est un fait mesurable que les francophones en situation minoritaire sont surmédicamentés. », souligne Normand Glaude, avant de citer Eric Forgues, directeur général de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques à l’Université de Moncton : « La concordance linguistique, si c’était un médicament, on voudrait la breveter. »
La peur de demander
La dizaine de résidents venus assister à la présentation sont intervenus pour témoigner de leurs préoccupations et expériences.
« Le sujet qui m’intéresse, moi, c’est la nourriture parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont ici et qui sont malades parce qu’ils n’ont pas de nourriture appropriée. », explique André Thériault qui épelle son nom de famille, « avec l’accent, mais ici, j’oublie l’accent »., s’amuse-t-il.
Diabétique sous insuline, il doit s’adapter à la nourriture disponible. « Souvent, je suis obligé de refuser et de demander d’autres choses […]. Je me rabats sur la dinde, il y a des choses que je peux avoir à volonté. […] Je trouve que les gens sont trop passifs et trop obéissants. Ils devraient déroger s’ils trouvent que ce n’est pas bon pour eux. »
Cet ancien traducteur vient en aide aux résidents unilingues. « Les Anglais, souvent, n’aiment pas entendre parler français. Ils vont demander aux francophones de parler anglais […]. Quand ça arrive, je traduis pour les francophones. »
Dans la salle, la crainte de revendiquer des services en français est soulevée.
« On a peur de la réaction de l’autre. S’ils savent que tu es francophone, ils vont moins s’occuper de toi. », lance une participante. « Moi, ça m’est déjà arrivé d’appeler le 911, puis ils ne parlent pas français. »
« Si tu es dans une situation de vulnérabilité, tu te sens peut-être moins à l’aise de revendiquer quelque chose. Tu n’as peut-être pas la force, tu te dis vraiment : « Tout ce que je veux, c’est de l’aide, pas nécessairement dans ma langue. » Mais la réalité, c’est que s’ils réussissent à avoir les services dans une langue dans laquelle ils sont plus habiles, le résultat de cette interaction-là devrait être davantage positif. […] Ce que les études démontrent, c’est que ce n’est pas une question de caprice, c’est vraiment une question de rendement du système. », précise Normand Glaude.
« Il ne faut pas avoir peur de le demander et si on sait que le service devrait être offert en français selon la loi, alors on peut également porter plainte à l’organisme ou à l’Ombudsman, ou communiquer avec notre réseau qui prendra vos témoignages et va tenter de communiquer avec l’organisme pour tenter de trouver des solutions. »
Le directeur du Rssfeo souligne qu’alors que l’Ombudsman a seulement reçu 8 plaintes l’année passée, grâce à son sa ligne anonyme, le réseau en a recueilli 37.